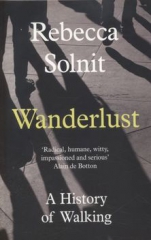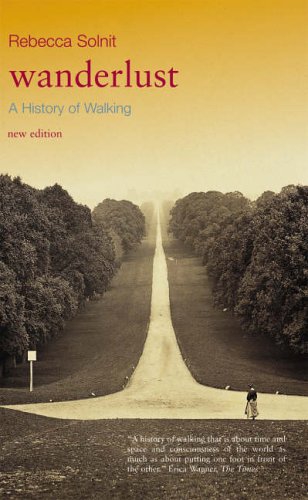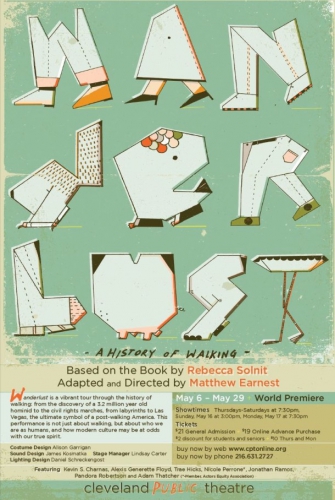« Le succès des marches ou des promenades collectives peut certes surprendre, tant ceux qui aiment aller à pied mettent en avant le désir d’indépendance, l’amour de la solitude, le sentiment de liberté dû à l’absence de structures et d’embrigadement. Le plaisir d’arpenter le monde à pied repose toutefois sur trois conditions préalables : il faut avoir du temps libre, un endroit où aller, un corps que ni la maladie ni les codes sociaux ne handicapent.
Ces libertés fondamentales furent l’objet de luttes innombrables, et il était parfaitement logique que les organisations ouvrières qui se battaient pour ramener la journée de travail à dix, puis huit heures, la semaine de travail à cinq jours, se préoccupent également des espaces où jouir de ce temps libre durement gagné. Ce combat ne se résume d’ailleurs pas, comme pourraient le laisser penser les pages qui précèdent, à l’espace naturel et rural ; l’aménagement des parcs urbains a aussi derrière lui une longue histoire, liée à l’ambition démocratique et romantique d’offrir les vertus de la vie campagnarde aux citadins qui n’avaient pas les moyens de s’échapper des villes. »
Rebecca Solnit, L’art de marcher